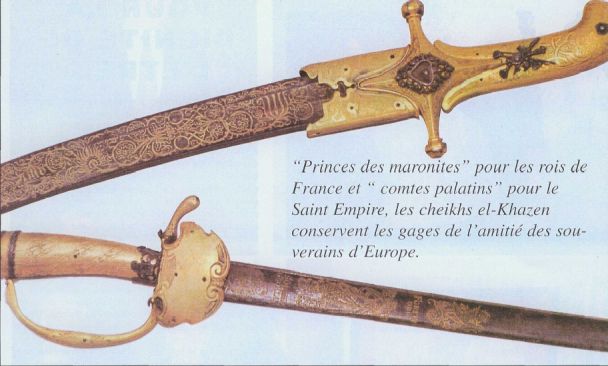L’évolution : mythe ou réalité ?
Introduction
Nous allons commencer cette étude par l’observation d’un petit animal, l’abeille, dont vos connaissez sans doute à peu près l’étonnante organisation de sa ruche… Mais connaissez-vous toutes les surprenantes particularités de toute abeille… ? (La Genèse au risque de la science, pp. 46-47)
Avouez qu’il y a de quoi être émerveillé par ce petit insecte qui pèse moins d’un gramme qui est équipé de dispositifs parfaitement adaptés à des besoins très divers !
D’ailleurs, ce que vous venez de découvrir chez une simple abeille, vous pourriez le découvrir avec une diversité infinie de trouvailles chez d’innombrables animaux, qui ont des particularités uniques en leur genre et qui leur permettent de faire face à des situations et des besoins spécifiques ; le cas de la chauve-souris et de son sonar (utilisant la réflexion des ultrasons) ou celui du chameau et de ses sabots tout-terrain méritent le retour… Et je ne parle pas d’où vient la coordination qui existe entre tous les animaux et végétaux d’un même site (chaîne alimentaire…) ; tout cela est parfaitement agencé. La question qui vient à l’esprit est : comment toutes ces adaptations admirables ont-elles été inventées et mises en places ? Ou plutôt par qui ?
Pendant des dizaines de siècles, la plupart des hommes ont répondu : c’est un Etre transcendant (d’un ordre supérieur) à notre monde visible, qu’on appelle Dieu, qui les a créés tels quels. On ne peut pas observer, par exemple, la petite épine sur l’une des pattes antérieures de l’abeille, épine dont elle se sert pour extraire le pollen du sac disposé sur une autre patte, sans se dire : un être intelligent a bien dû penser tout cela !
Et pourtant, depuis plusieurs décennies, une réponse très différente est proposée : en résumant, tous les êtres vivants actuels seraient apparus progressivement au long de centaines de millions d’années, depuis un premier organisme très simple, unicellulaire, selon un processus de transformation des uns à partir des autres, en passant par des organismes de plus en plus complexes, jusqu’à l’homo sapiens sapiens (ou homme de Cro-Magnon, semblable à l’homme actuel) descendant d’un primate supérieur. Aujourd’hui, les scientifiques ont érigé l’hypothèse de l’évolutionnisme – appelé aussi transformisme – en dogme énoncé dans les manuels scolaires, les livres, les magazines, les reportages télévisés, les conférences, les expositions, et même les livres de la plupart des théologiens et ecclésiastiques, qui pensent concilier foi et évolution matérialiste (puisque l’homme viendrait de la matière).
Mais en réalité, beaucoup de savants n’y croient que par horreur du vide, dans l’incapacité où l’on se trouve à trouver une autre théorie. Un ancien directeur du Muséum d’histoire naturelle, Lemoine, notait déjà , il y a plus de soixante ans : « L’évolution est une sorte de dogme auquel ses prêtres ne croient plus mais qu’ils maintiennent pour le peuple. » En fait, écrivait le professeur Delage : « Je suis absolument convaincu qu’on est ou qu’on n’est pas transformiste, non pour des raisons tirées de l’histoire naturelle, mais en raison de ses opinions philosophiques. » Et il écrivait cela en 1903 ! S’il vivait encore, il pourrait ajouter que l’histoire naturelle ne s’est pas montrée, depuis, favorable à l’explication évolutionniste (par exemple, par les découvertes en génétique, en biologie moléculaire… qui contredisent l’évolutionnisme, comme nous le verrons plus loin).
I. La théorie évolutionniste
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’évolutionnisme n’est pas une hypothèse scientifique . Pour qu’une hypothèse puisse être dite scientifique, il faut que les faits qu’elle revendique soient observables, contrôlables et en principe reproductibles en laboratoire selon des méthodes rigoureuses. Or la plupart des faits invoqués par l’évolutionnisme appartiennent au passé et échappent donc aux examens de la Science. D’ailleurs, aucun fait d’évolution (un être vivant gagnant un nouvel organe…) n’a jamais pu être constaté directement. Toutes les expériences faites pour ce résultat ont échoué (nous parlons toujours de la « macroévolution », d’une espèce à l’autre).
1) Brève histoire de l’évolutionnisme
L’évolutionnisme apparaît donc plutôt comme une théorie « métaphysique », c’est-à -dire qui dépasse les possibilités de la Science et rejoint la philosophie. C’est ainsi qu’on en retrouve les prémices dans l’Antiquité chez les penseurs de tendance matérialiste, comme Thalès, Héraclite, Empédocle, Epicure…
L’évolutionnisme réapparaît après le Moyen Age chrétien, dans l’irréligion du « siècle des Lumières », avec notamment Buffon qui pensait qu’en battant un animal on dotait sa descendance d’une carapace ; puis au XIXe Geoffroy Saint-Hilaire, et Lamarck, qui fonde l’évolution sur une tendance innée de l’animal à se perfectionner pour faire face à des conditions nouvelles ; par exemple, des générations de girafes auraient peu à peu allongé le cou pour brouter dans les arbres… Ainsi la formule « la fonction crée l’organe » est typiquement lamarckienne.
Enfin paraît Charles Darwin, avec son fameux livre De l’origine des espèces, daté de 1859, qui fonde l’évolution sur le principe de sélection naturelle selon lesquels, seuls les individus les mieux adaptés à leur environnement survivent, se reproduisent et assurent la transmission des caractéristiques de leur espèce. Les autres, moins favorisés, finissent par disparaître. C’est déjà vers 1880, que l’évolution est acceptée par l’ensemble des biologistes. C’est encore le cas aujourd’hui.
Toutefois, la découverte de l’ADN (rappel de cette notion si besoin) en 1953 a ajouté à ce principe de sélection celui des mutations qui frappent les gènes au hasard, engendrant des modifications sur la descendance. On appelle ce principe « mutation-sélection » (exemple de la girafe) le néo-darwinisme.
2) Principaux arguments évolutionnistes
Tout part de cette observation : les ressemblances entre certaines espèces animales suggèrent la parenté, donc une filiation, et donc une évolution à partir d’une souche commune.
L’anatomie comparée fournit un premier argument : en effet, on s’aperçoit que la plupart des animaux sont constitués sur un même plan d’organisation, avec des axes communs : axe dorso-ventral, antéropostérieur, droite-gauche, et des organes homologues, qui dans de la majorité des espèces présentant le même plan d’organisation. Par exemple, dans la main de l’homme, la patte du cheval et l’aile de la chauve-souris, qui ont des fonctions différentes, on reconnaît les mêmes connexions avec le corps et les mêmes os plus ou moins modifiés.
Un autre argument est tiré de l’embryologie ; l’embryon humain semble passer au cours de son développement par les divers stades de l’évolution : d’abord unicellulaire, il ressemble ensuite aux invertébrés, puis aux poissons dans le liquide amniotique, etc. C’est ainsi que le cÅ“ur du fÅ“tus humain, à l’origine un simple tube, comporte ensuite deux cavités comme les reptiles, trois comme les amphibiens, avant d’en compter quatre comme les mammifères. En réalité, il n’y a là que des ressemblances superficielles s’expliquant par la formation progressive des organes, tout simplement ! Un embryon humain, dès la première cellule, possède tout le capital génétique de l’homme.
La biogéographie (qui étudie la vie sur la terre) fournit également des arguments. Par exemple, les marsupiaux (ces mammifères, comme le kangourou, qui portent leurs fÅ“tus dans une poche extérieure) apparurent quand l’Australie, dit-on, était unie à l’Amérique ; or les marsupiaux vivant actuellement dans ces deux continents présentent des différences qui montreraient qu’ils ont évolué séparément après l’isolement de l’Australie, à cause de la différence de milieu. Toutefois, cet argument ne plaide qu’en faveur d’une évolution limitée : les formes se modifient à l’intérieur des espèces sans changement de types ni apparition d’organes nouveaux. Nous verrons plus loin que cette microévolution ne prouve nullement l’évolutionnisme.
La paléontologie (étude des fossiles laissés dans les sédiments par les êtres ayant vécu aux époques géologiques) apporte de nombreux arguments : la faune et la flore se modifient à chaque ère géologique et il y a globalement un développement progressif des espèces vivantes par l’apparition de nouveaux groupes de plus en plus complexes. Toutefois, on ne peut pas dire qu’il y ait des progrès à l’intérieur de ces groupes qui, souvent, régressent ou disparaissent (exemple : dinosaures).
La comparaison des êtres vivants en permet le classement en divisions de plus en plus fines (classes, ordres, familles, genres, espèces, variétés, races…) et c’est ainsi qu’on a construit un arbre généalogique des êtres vivants, en partant des espèces actuelles jusqu’à un premier être unicellulaire et en passant par les quelques fossiles ; mais en fait il manque la plupart des espèces intermédiaires.
Enfin la biochimie (qui traite de la chimie des molécules des êtres vivants) a permis aux évolutionnistes de dire que si l’ADN s’enrichissait, au fur et à mesure que les organismes devenaient plus complexes et qu’apparaissaient des fonctions nouvelles, c’était parce que les animaux descendaient d’un ancêtre commun. Ainsi en l’homme se retrouveraient des éléments des gènes des divers êtres vivants qui ont précédé son apparition…
III. Faiblesses de la théorie
Nous allons voir l’évolution étape par étape : d’abord le moteur de l’évolution, puis l’origine de la vie, celle des espèces, l’apparition des espèces, le mécanisme de l’évolution et enfin la lignée humaine.
1) Le moteur de l’évolution
Sans doute quitterons-nous le domaine de la Science pure pour examiner la question, mais c’est inévitable et les évolutionnistes n’agissent pas autrement : nous l’avons dit, leur hypothèse est d’abord métaphysique.
Pour les matérialistes, l’évolution est guidée par le hasard, d’une matière éternelle (= sans commencement ni fin). Or, si la matière a toujours existé, c’est qu’elle est ce qu’elle est, qu’elle se tire elle-même du néant, qu’elle possède finalement des attributs divins. Le matérialisme se résout ainsi, non en un athéisme, mais en un panthéisme (= Dieu est l’univers). D’ailleurs, il est prouvé que la matière n’est pas éternelle, puisqu’on voit que les étoiles vieillissent et disparaissent, et que le Soleil explosera dans quelques milliards d’années maximum.
Cependant, quel que soit le moteur de l’évolution, l’appellerait-on même hasard, il faut bien constater que l’évolution réalise un plan cohérent avec l’apparition successive du cadre de vie, des premiers êtres vivants, des espèces de plus en plus perfectionnées, de l’homme enfin. L’univers forme un ensemble parfaitement ordonné et harmonieux. Cela ne peut résulter que d’un plan conçu par une intelligence créatrice ! Ou alors, si l’on croit que c’est seulement le hasard qui mène l’évolution, c’est-à -dire une suite d’événements totalement aléatoires, que pourrait-il en résulter, sinon un chaos ?
On pourra répondre à cela que la sélection naturelle explique suffisamment la conservation d’un avantage acquis par hasard. Mais l’on voit dans bien des cas que, à en croire les évolutionnistes, un tel avantage n’apparaît que progressivement et qu’il se trouve précédé par des étapes ou l’avantage futur n’apporte, avant d’être effectif, que des inconvénients que la sélection aurait dû éliminer. Est-ce que cela existe, un hasard qui puisse prévoir, anticiper, préparer ? Les savants introduisent donc, de manière souvent implicite, un élément d’allure métaphysique, qu’on appelle « force évolutive », ou « élan vital » pour Bergson, « téléfinalité » pour Lecomte de Nouy, « déterministe téléologique » pour Cuénot, bref une impulsion étrangère mystérieuse…
Mais on peut dire que toutes les combinaisons possibles ont eu le temps de se produire… En fait, on a calculé que pour réaliser tous les états possibles d’un gène d’importance moyenne (soit mille paires de nucléotides), il fallait 10500 années… Ce qui est beaucoup trop long ! D’ailleurs, même si la matière était éternelle, il resterait bien des traces des essais infructueux, et l’on verrait apparaître les traces de nouveaux essais… A moins que les essais soient terminés, ce qui prouverait que la matière n’est pas éternelle, soit que l’évolution suit un plan qui dicte des étapes que le hasard ne peut inventer. Bref, il y a eu une chance sur une infinité pour que l’univers soit tel qu’il est, tellement bien organisé (souvenez-vous de l’abeille !), si bien que dès que quelque chose est changé (exemple : on enlève un élément de la chaîne alimentaire) tout est « détraqué »… et comme par hasard ce serait sur cette chance qu’on serait tombé… !
Si l’on admet que la création s’effectue sous la forme d’une évolution lancée par un acte initial, il faut bien que tout son programme soit inscrit dans la matière de façon à pouvoir déclencher successivement les opérations évolutives ; ainsi, l’ADN des premiers êtres unicellulaires aurait dû contenir le code des millions d’espèces plus ou moins complexes à venir ! En réalité, les êtres unicellulaires actuellement existants possèdent mille fois moins de nucléotides, donc d’informations, que n’en reçoit l’homme dans le sien… Ils ne pourraient donc pas donner naissance par évolution à des millions d’espèces comprenant celles de l’homme !
En résumé, la thèse évolutionniste se trouve contrainte à faire intervenir des facteurs surnaturels relevant soit du panthéisme, soit du créationniste. Elle ne sort pas pour autant d’un réseau de contradictions et d’impossibilités qui suffisent à démontrer son invraisemblance…
2) L’origine de la vie
Le point de départ de l’évolution serait l’émergence de la vie dans la matière inanimée (= sans vie ni mouvement).
Mais d’abord qu’est-ce que la vie ? Comme il n’en existe pas de claire définition, on se contente de la présenter comme l’exercice des fonctions de l’être vivant. Qu’est-ce que l’être vivant ? En résumant, c’est ensemble matériel organisé qui, par d’échanges avec le milieu ambiant, se nourrit pour renouveler sa substance, s’adapte dans certaines limites aux variations du milieu, et façonne des êtres semblables à lui-même. Les seuls points communs que l’on puisse trouver entre la matière vivante et la matière inanimée, ce sont les éléments chimiques qui composent leurs molécules, mais il n’y là rien d’étonnant puisque les êtres vivants puisent leur substance dans la matière inanimée (exemple : un homme qui mange du sel).
Comment la vie aurait-elle donc pu naître de la matière brute ? La Science ne montre absolument aucune tendance en ce sens. Pour débloquer la situation, les évolutionnistes imaginent un scénario au cours desquels la rencontre accidentelle de certaines substances se trouvant par hasard dans les proportions requises… a donné, par des réactions chimiques fortuites, de premiers organismes très simples mais vivants. Mais cet enchaînement de chances, nous dit Rosnay – un grand scientifique -, est si peu probable qu’il n’aurait pu se réaliser qu’une seule fois en quelques milliards d’années… En fait, l’incapacité de notre intelligence à concevoir de grands nombres nous fait presque considérer quelques milliards d’années comme équivalents à l’éternité ; en réalité, ces temps sont ridiculement trop brefs pour donner un semblant de vraisemblance à la moindre hypothèse évolutionniste. Dans le cas présent, il ne faudrait pas parler de très faible probabilité, mais bien de rigoureuse impossibilité.
Les premières molécules se seraient regroupées au fond des océans, formant ainsi la soupe primitive appelée aussi boue primordiale ; les molécules se combineraient en macromolécules (très grandes molécules) sous l’action nécessaire de catalyseurs minéraux (= substance qui entraîne une réaction chimique) supposés mais inconnus. Mais ensuite, comment pourraient-elles constituer elles-mêmes des êtres vivants ? Suffit-il de pièces détachées dans une caisse pour avoir un moteur ? Les évolutionnistes franchissent une fois de plus la frontière du métaphysique en imaginant que les macromolécules ont acquis (où ? comment ?) la capacité de grandir, de se multiplier, de réagir les unes sur les autres.
Et ensuite, suffit-il de monter un moteur pour qu’il commence à tourner ? La vie ne résulte pas d’un simple assemblage de molécules.
D’ailleurs, les premières cellules primitives qu’on a reconstituées expérimentalement et appelées protobiontes ne ressemblent que de très loin à la plus modeste cellule vivante, qui est en fait un organisme très complexe fonctionnant selon des modalités précises qui excluent la possibilité d’évolution à partir de stades inférieurs : sans quoi la cellule de fonctionnerait pas ! Le noyau contient l’ADN qui est composé de milliers d’anneaux rangés dans un ordre rigoureux ; la moindre inversion d’anneaux détraquerait le mécanisme. Comment le hasard, à supposer qu’il ait pu enfiler tant d’anneaux, aurait-il pu trouver le bon ordre ?
Le problème se complique du fait de la dissymétrie des molécules organiques (= des organismes vivants), découverte par Pasteur. En effet, ces molécules dévient la lumière polarisée soit à gauche (elles sont sénestrogyres), soit à droite (dextrogyres). Or, les molécules produites dans les synthèses de l’atmosphère et de la soupe primitives, obtenues par expériences, ne dévient d’aucun côté et sont symétriques (ou encore racémiques). Lecomte de Nouy, grand biologiste, a calculé que, pour que le hasard ait eu le temps de former une seule macromolécule dissymétrique, il lui aurait fallu 10243 milliards d’années, alors que la terre n’est âgée que de 59 milliards d’années… Qu’est-ce que serait alors le temps pour monter une cellule entière, un être vivant…
On peut donc se poser la question quant à l’impossibilité de l’évolutionnisme.
3) L’origine des espèces
Si l’on veut maintenir la fiction de l’émergence progressive de la première cellule vivante ou celle de son soudain surgissement, il faut admettre que cette cellule était unique ; il s’agit du monogénisme qui s’oppose au polygénisme, selon lequel les mêmes modifications se produisent dans des cellules différentes. En effet, s’il y avait plusieurs origines, il y aurait plusieurs systèmes ; car il n’existe quasiment aucune probabilité pour que les mêmes modifications se soient réduites très exactement en deux ou, plus improbable encore, plusieurs exemplaires. Le monogénisme s’explique donc scientifiquement.
Revenons à notre unicellulaire qui se serait reproduite et diversifiée en deux lignées : les protophytes, d’où serait venu le règne végétal, et les protozoaires, ancêtres supposés du règne animal. Ici apparaît une première difficulté : nous savons que les animaux dépendent des végétaux pour leur alimentation ; donc les ancêtres des végétaux ne pourraient apparaître qu’avant ceux des animaux, sinon ceux-ci ne pourraient se nourrir. Cependant, les protophytes fabriquent eux-mêmes leur matière organique (leur « corps ») à partir des minéraux et de certains pigments comme la chlorophylle. Ils se « construisent eux-mêmes », et présentent donc un avantage par rapport aux animaux ! S’ils sont apparus avant, il ne s’agit pas d’une évolution puisque les animaux n’ont pas cet avantage, mais d’une régression. Selon le principe de sélection naturelle, l’avantage des protophytes aurait donc provoqué la disparition par compétition des protozoaires !
D’ailleurs, si les êtres unicellulaires ont donné naissance à tous les êtres pluricellulaires, pourquoi subsiste-t-il de nos jours, sans changement, tant de ces êtres unicellulaires ? Pourquoi n’ont-ils pas évolué eux aussi ?
Des protozoaires seraient sortis les animaux pluricellulaires ou métazoaires. Mais en fait, une juxtaposition de protozoaires ne forme pas un métazoaire… Celui-ci comporte un certain nombre de cellules constituant des organes distincts affectés aux différentes fonctions : mais il ne constituent qu’un seul individu ! En effet, il y a une énorme séparation entre les unicellulaires et les pluricellulaires ; il faudrait une si importante mutation sur l’ADN qu’elle en devient tout à fait impossible. En particulier, il faudrait qu’un être unicellulaire, sans sexe, produise un être pluricellulaire donnant des gamètes ne comportant que la moitié des chromosomes, et un autre individu dont les gamètes seraient exactement complémentaires à l’autre sexe ! C’est assez invraisemblable. Le phénomène de l’origine des espèces paraît donc à peu près impossible.
4) L’apparition des espèces ou ce que nous apprend la paléontologie
D’abord quelques remarques préalables : comme peu d’espèces se sont fossilisées et qu’on a découvert qu’une faible partie de ces fossiles, le plus ancien et le plus récent fossiles d’une espèce ne donnent en aucun cas les dates d’apparition et de disparition de cette espèce. Bien des espèces ont pu vivre longtemps de manière discrète avant que des conditions favorables, un changement de climat ou la disparition d’un concurrent ou d’un prédateur, ne favorisent chez elles une explosion démographique attestée par les fossiles. Bien d’autres ont pu survivre à leur dernier fossile. On a ainsi retrouvé, bien vivants au XXe siècle, quelques animaux que l’on croyait éteints depuis longtemps : tels un crustacé, la neoglyphea, ou le fameux coelacanthe, tous deux portés disparus depuis 60 ou 70 millions d’années… et bien d’autres encore. Ces faits, sans remettre en cause les modifications de l’aspect global de la faune et de la flore au cours des ères géologiques, ne vont pas dans le sens de l’évolutionnisme ; en tout cas, on voit que la chronologie des espèces se révèle très incertaine.
Au début de l’ère primaire, au Cambrien, apparaît un grand nombre de fossiles, qui appartiennent tous à des espèces marines. On en a conclu que la vie, sortie des océans, n’est apparue que beaucoup plus tard sur la terre ferme. Or, la terre ferme subit l’action destructrice de l’érosion alors que les fonds marins bénéficient de l’action conservatrice de la sédimentation. Et d’ailleurs, il fallait bien que la terre existât puisqu’elle a fourni les matériaux de la sédimentation.
Avant le Cambrien, on n’a retrouvé aucun fossile (des couches précambriennes sont vierges), alors qu’au Cambrien (il y a 550 millions d’années) on rencontre les fossiles de 500 espèces animales appartenant à sept embranchements différents. Il y a là aussi bien des crustacés et des éponges que des vers, des oursins ou des méduses, tous aussi différenciés que de nos jours. Et l’on n’a retrouvé aucun ancêtre et aucune espèce intermédiaire, alors qu’ils sont censés descendre d’un ancêtre commun…
Toutefois, il est indéniable que les grandes catégories animales et végétales sont très anciennement présentes sur la Terre ; ces catégories, d’après ce qu’on en sait, apparaissent de manière échelonnée, de sorte que les plus perfectionnées ou les plus complexes seraient aussi les plus récentes.
Prenons un exemple à l’intérieur d’une grande catégorie de végétaux, les thallophytes (algues, bactéries). Dès que l’on possède des fossiles terrestres, au Silurien, on compte une espèce, les psilophytes, qui disparaîtront rapidement après une grande extension, et aussi des lycopodes et des prêles. Les fougères et les conifères s’y ajouteront, et également les mousses (bryophytes) bien que de morphologie beaucoup plus « primitive ». C’est pendant l’ère secondaire que l’on voit apparaître, ou, au moins, se développer, les plantes et arbres à fleurs.
Certes, on remarque l’apparition échelonnée dans le temps des fossiles d’espèces de plus en plus perfectionnées. Toutefois, on ne doit pas confondre date du premier fossile et date de naissance de la plante : l’actuelle isoète paraît bien la fille de la sigillaria ; or leurs fossiles réciproquement les plus proches sont distants de 100 millions d’années. En outre, bien des plantes dites primitives survivent à côté de leurs prétendues descendantes : les bactéries, mousses, fougères et conifères subsistent à côté de leurs prétendus descendants : la prêle, le pied-de-loup ou le ginkgo biloba ! Pourquoi n’ont-ils pas évolué comme eux ? Enfin, on ne trouve aucune forme intermédiaire qui puisse prouver le passage par évolution des plus anciens aux plus récents. Et l’on peut dire cela pour la plupart des espèces.
Plus tard, la terre cependant connaît des explosions démographiques ; la plus spectaculaire concerne les reptiles de l’ère secondaire, il y a environ 225 millions d’années, dont les fameux dinosaures qui peuvent dépasser 20 m de long alors que le volume de leur cerveau n’atteint pas celui d’un Å“uf de poule ! Quelques millions d’années plus tard, ils disparaissent, laissant des espèces plus modestes (tortues, crocodiles, serpents…). Ces apparitions et ces disparitions sont dues à des modifications climatiques et géographiques, et en même temps à la régression ou l’augmentation, dues à ces mêmes modifications, d’espèces concurrentes ou prédatrices.
Apparitions d’espèces gigantesques, souvent monstrueuses (ex : libellules de 75 cm d’envergure…), multiplications des types ou des formes, voilà enfin, nous dira-t-on, des preuves d’évolution. On nous montrera aussi, entre autres nombreux exemples, la fameuse série évolutive des paludines de Slavonie ; il s’agit de mollusques d’eau douce dont les coquilles se sont sculptées et couvertes de reliefs, à mesure que les générations se sont succédées. Ou encore la généalogie du cheval qui montre comment un petit mammifère herbivore est devenu, en 50 millions d’années, un grand mammifère herbivore. On est loin de l’évolution du protozoaire qui donnera le jour au papillon comme au rhinocéros. Il existe donc une évolution, mais pas de celle dont nous parle l’évolutionnisme : il s’agit d’une microévolution, c’est-à -dire d’une évolution au sein de l’espèce – qui est tout à fait naturelle, par le jeu des mutations génétiques aléatoires -, qui apporte quelques modifications morphologiques, mais qui ne forme pas de nouveaux organes, qui n’invente pas de nouveaux systèmes au point de faire dériver la faune et la flore passées et présentes d’une souche unique constituée d’êtres unicellulaires, et enfin qui ne présente pas une évolution progressive, mais défavorable ou plutôt neutre pour celle des paludines : y a-t-il un avantage à avoir une coquille ornée plutôt que lisse ?
D’ailleurs, ces preuves d’évolution de détail soulignent l’absence de preuves des grandes évolutions supposées. Il va de soi que les innombrables formes intermédiaires, qui auraient marqué le passage du protozoaire aux vertébrés supérieurs en passant par les invertébrés, auraient dû laisser infiniment plus de traces fossiles que les petites microévolutions…
On a essayé de trouver, par exemple, un intermédiaire entre les invertébrés et les vertébrés sous la forme de très petits animaux que l’on dénomme protocordés, chez qui on reconnaît un rudiment de moelle épinière le long d’une tige rigide ou corde dorsale, mais on ne connaît aucune forme de passage entre les invertébrés et ces protocordés ni entre ceux-ci et les vertébrés. La tentative de raccordement paraît bien artificielle : à s’en tenir ainsi à une seule ressemblance anatomique, ne devrait-on pas faire de la pieuvre le cousin sinon le père de l’homme, compte tenu de la quasi-indenté de leurs yeux ?
Les évolutionnistes tiennent pour assuré que les poissons sont les ancêtres des vertébrés qui peuplent les eaux, la terre et l’air : en effet, certains poissons du Dévonien (ère primaire) nommés crossoptérygiens, possédaient des nageoires pourvues d’un squelette, qui auraient permis à leurs descendants de ramper hors de l’eau pour s’adapter à la vie terrestre. Mais d’abord, si ces nageoires apporteraient un avantage aux descendants, elles désavantageraient dans l’immédiat les poissons qui s’en trouveraient affligés… On ne voit pas comment la sélection naturelle aurait pu favoriser un handicap au profit d’un avantage lointain ; elle l’aurait éliminé dès son apparition. Ou alors il faut une fois de plus faire appel à un agent métaphysique, pour ne pas dire surnaturel : une mystérieuse force évolutive… D’ailleurs, les crossoptérygiens, qui ne constituent en somme qu’une forme de passage, aurait dû disparaître logiquement il y a plusieurs centaines de millions d’années… mais on a retrouvé au XXe siècle une espèce parfaitement vivante : le coelacanthe. Il serait étrange de voir que certains crossoptérygiens auraient donné naissance aussi bien à l’homme qu’au serpent ou à l’écureuil, alors que d’autres ne changeraient pas d’une écaille…
D’autre part, on a essayé de relier les mammifères aux reptiles en recherchant parmi les reptiles éteints ceux dont le squelette ressemble le plus à celui des mammifères ; mais il ne faut pas perdre de vue que cette démarche, la seule qu’autorisent les fossiles, néglige des points très importants par lesquels les mammifères se distinguent des reptiles ; citons l’homéothermie ou système régulateur de la température interne (le « sang chaud »), la viviparité avec le développement interne de l’embryon, la lactation (production et régulation du lait), les phanères (poils, sabots, ongles)…
L’arbre censé présenter la « généalogie » des espèces énonce clairement l’hypothèse évolutionniste ; il reste encore à chercher les preuves qui le confirmeraient. Or, par un singulier abus, on a fait de cet arbre la preuve de l’évolutionnisme ! Une boutade de Jean Servier l’illustre bien : « On peut tout aussi bien réaliser de pareilles chaînes évolutives à partir des objets qui nous entourent et prouver que le bâton est l’ancêtre du lit, en passant par le pliant, le tabouret, le fauteuil et le canapé. » C’est absurde.
En résumant, nous pouvons dire que tous les embranchements animaux sont présents, aussi différenciés qu’aujourd’hui, dès le début de l’ère primaire. Puis chaque période voit l’un ou l’autre se multiplier, se diviser en de nombreuses variétés et se stabiliser. A partir de l’ère secondaire, les explosions démographiques se produisent surtout à l’intérieur de l’embranchement des vertébrés et sont le fait d’espèces de plus en plus complexes et perfectionnées. Toutefois, de nombreuses espèces n’ont jamais évolué et survivent néanmoins à la sélection naturelle. D’après la théorie évolutionniste, les progrès viennent d’une évolution qui crée peu à peu, à partir les unes des autres, des espèces de plus en plus perfectionnées. Or les espèces les plus perfectionnées apparaissent brusquement et rien ne les relie aux espèces précédentes ; de plus la paléontologie, nous venons de le voir, n’a découvert aucune des formes intermédiaires qui devraient foisonner. Les très rares exemples cités sont moins que discutables et on n’y trouve en tout cas jamais l’ébauche d’un organe nouveau. Certes, l’absence de preuves positives concernant l’évolutionnisme n’équivaut pas à une preuve négative ; mais l’absence de preuves négatives ne peut tenir lieu de preuve positive ! Enfin, l’évolutionnisme, impossible par divers aspects, n’a pas vraiment une base paléontologique sérieuse.
5) Le mécanisme de l’évolution
Lamarck imaginait que les êtres vivants se modifiaient pour s’adapter aux conditions extérieures et que ces modifications acquises et se transmettaient héréditairement. Il pensait même que des organes nouveaux pouvaient apparaître ainsi. Mais on sait maintenant que seuls peuvent se transmettent les caractères inscrits dans le capital génétique (ADN, ci-contre). C’est pourquoi la théorie actuellement reçue veut que des accidents affectent ce capital au cours de la reproduction, que certains individus bénéficient par là de mutations avantageuses, que les individus non pourvus de ces avantages soient éliminés par la sélection naturelle et qu’il en découle en définitive une évolution progressive.
On peut certes discuter de l’efficacité de la sélection naturelle lorsqu’on voit tant d’animaux affligés de bois incongrus ou d’appendices gênants. Et plus encore lorsque l’on dénombre les millions d’espèces que la concurrence aurait dû éliminer, et notamment toutes celles qui, venues intactes du fond des âges, n’ont ni bénéficié ni souffert du progrès général.
Les accidents génétiques existent. Ils provoquent en général la mort de leurs porteurs. Ils peuvent amener dans certains cas des modifications ou mutations. Mais ces mutations sont beaucoup plus facilement récessives que progressives : s’il suffit, par exemple, de bloquer un seul nucléotide d’un seul gène pour décolorer une souris grise, il faut en revanche « créer » 27 gènes, soit 27 000 nucléotides pour l’opération inverse.
Les mutations ne peuvent donc porter que sur les caractères secondaires. Seraient-elles plus importantes qu’elles ne pourraient se transmettre à moi d’apparaître, par une bien étrange coïncidence, à la fois au même lieu chez un mâle et chez une femelle.
L’apparition d’un organe ne pouvant donner un avantage que si cet organe peut d’emblée exercer sa fonction, on ne peut envisager sérieusement la croissance progressive, d’ailleurs jamais constatée, d’organes pas encore complètement développés que la sélection ne pourrait qu’éliminer. Une apparition brusque paraît tout aussi impossible.
Celle de l’Å“il aurait supposé, non seulement la formation soudaine d’un organe très complexe et, qui plus est, monté en double en liaison avec le centre optique, mais aussi un remodelage complet du corps bénéficiaire : squelette, musculature, irrigation sanguine, innervation.
Et les mathématiciens, comme Georges Salet, estiment que le hasard n’a pas eu le temps, depuis la création de la matière, de former un seul organe nouveau.
6) La lignée humaine
Beaucoup d’évolutionnistes limitent leur ambition à tracer une généalogie de l’homme qui ne prend un peu de consistance qu’à partir de fossiles d’anthropoïdes. Ces anthropoïdes possédant en gros les mêmes organes et la même structure générale que l’homme, on pourrait penser à partir d’eux à une évolution limitée qui ne relèverait pas de l’impossible évolutionnisme.
Avant de passer brièvement en revue nos ascendants supposés, il nous faut jeter un Å“il sur les méthodes de datation fondées sur la dégradation des atomes radioactifs ; par exemple, le potassium se transforme en argon à une vitesse constante ; pour connaître l’ancienneté d’une roche, il suffit d’établir sa teneur en ces deux corps. Malheureusement cette méthode ne permet pas d’évaluer de dates plus récentes qu’un million d’années environ. Le radiocarbone ou C14 se décompose de même dans les corps organiques en carbone C12. Ces méthodes, bien qu’admises par la science, présentent quelques limitates. D’abord, la quantité de C14 n’était pas forcément la même à l’origine que maintenant ; elle a pu varier au cours du temps en fonction de divers facteurs . Ensuite, la vitesse de décomposition peut varier en fonction des conditions physiques subies par l’échantillon étudié. Ainsi, par exemple, certains rayonnements ou de hautes températures modifient la vitesse de transformation du C14. De plus, cette méthode ne permet pas d’être appliquée à des dates remontant au-delà de 50 000 ans. Entre le potassium-argon et le C14, aucune datation ne couvre le million d’années qui aurait du apparaître les plus proches ancêtres de l’homme ; on a essayé d’autres méthodes qui permettent d’établir une chronologie relative mais assez confuse, qui se heurte à un bon nombre d’incohérences . Il arrive ainsi qu’un événement daté de milliers d’années par radiocarbone le soit de millions par potassium-argon !
Une spécialiste de la radio-chronologie, le docteur Marie-Claire Van Oosterwuck-Gastuche, note que les âges indiqués dans les manuels (entre 225 et 70 millions d’années) ne reposent sur aucune mesure directe sur les ossements, mais sur des estimations indirectes dépendantes des dates officielles de l’échelle stratigraphique ; en fait, la stratigraphie (qui détermine l’âge des couches de l’écorce terrestre) s’appuie sur les fossiles pour dater les couches de terrain, et la paléontologie s’appuie sur l’âge des couches géologiques pour établir son arbre généalogique des espèces ! C’est un cercle vicieux… Les méthodes de datations ne sont donc pas très fiables…
Mais d’abord, pour qu’un animal devienne un homme, il faut qu’il change le nombre de ses chromosomes (le singe en a 48 et l’homme 46), ce qui est absolument peu probable sans que cela provoque une anomalie. Ensuite, on dit que le volume cérébral des premiers hominidés a augmenté en fonction du développement de ses capacités intellectuelles. Or, le cerveau d’Anatole France ne dépassait pas le volume d’un sinanthrope, tandis que le cerveau de l’éléphant est plus volumineux que celui de l’homme. La différence entre l’animal et l’homme n’est pas quantitative (volume) mais qualitative : l’homme n’a pas un simple instinct mais une volonté libre, une intelligence créatrice, capable de juger et de raisonner ; volonté et intelligence sont d’ailleurs les facultés qui distingue l’homme des animaux. A-t-on déjà vu un singe admirer un coucher de soleil, faire des sacrifices pour un autre singe, avoir de l’humour, prier, méditer, écrire, fabriquer des machines, programmer…etc. ?
D’ailleurs, les facultés intellectuelles du petit d’homme ne se développent qu’au contact et à l’exemple des adultes (à la différence des enfants-loups…). Si une heureuse mutation avait pourvu un hominidé de ces facultés, il n’aurait jamais pu les développer. On voit d’ailleurs là qu’on est un homme ou on ne n’est pas, une lente « hominisation » est impossible.
D’autre part, il est étrange qu’il ne soit rester aucun des hominidés soi-disant ancêtres de l’homme, tandis qu’il reste des musaraignes dont on dit qu’elles représentent le plus ancien ancêtre de l’homme.
Avant la fameuse « Lucy » découverte il y a environ 3 millions d’années, on n’a trouvé que de rares débris fossiles. Elle fait partie des australopithèques (sachant que pithecos signifie singe), dont on a cru pouvoir attribuer l’invention du feu, mais les traces retenues étaient en fait celles d’un incendie. On avait même créé un type australopithecus prometheus du nom du mythique voleur de feu !
Vient ensuite l’homo habilis ; on a daté 1,5 millions d’années des outils découverts sur le site où ont été retrouvés les débris de l’homo habilis, mais la méthode potassium-argon donnait la date de la formation de la roche et non celle de sa taille en outil ! Ces australopithèques ne sont donc sans doute que des singes éteints depuis longtemps sans descendance !
Vient l’homo erectus, comprenant deux célébrités : le pithécanthrope et le sinanthrope. Voici l’histoire du premier : un Hollandais nommé Dubois se rendit à Java en 1890, dans le but d’y découvrir l’homme-singe, le pithécanthrope qu’avait inventé un biologiste de l’époque, Haeckel. Moins de deux ans après, il l’avait trouvé. Ou plus exactement, il avait trouvé sous la terre au fond d’un cours d’eau (donc une couche indatable) un crâne de gibbon géant (singe) et, à 15 mètres de distance, un fémur humain. Il reconstitua alors le « pithécanthrope », poils compris (comment a-t-on pu d’ailleurs démontrer que la pilosité des « hominidés » décroissait au fur et à mesure de leur évolution, avec pour seuls indices quelques os… ?) Les choses se gâtèrent un peu lorsque cinquante ans plus tard, Dubois reconnut avoir trouvé au même endroit, non pas un, mais cinq fémurs, ce qui parut beaucoup même pour un pithécanthrope. Il avait aussi découvert dans la même région, et apparemment contemporains, des crânes humains . Néanmoins, le pithécanthrope (ou homme de Java !) continue imperturbablement sa carrière : on lui attribue tels outils, on enseigne son existence dans les écoles… alors qu’il n’est qu’au début qu’une invention à partir de preuves plus que discutables…
Après l’homo erectus, qui ne se résume qu’à une collection de crânes de singes, vient un absent, si l’on peut dire, l’homme de Piltdown, dont les restes se limitent à un crâne d’homme et à une mâchoire d’un singe contemporain artificiellement vieillie … détenus au British Muséum ! Mais la fraude a été reconnue dans les années 50.
Quant à l’homme de Neandertal, connu par de nombreux squelettes, il semblerait être une branche dégénérée de l’homo sapiens disparue sans laisser de descendance, ce qui pourrait s’expliquer par un excès de consanguinité, car les néandertaliens, peu nombreux, vivaient en petits groupes, se mariaient entre eux et mouraient vers 20 ans environ, ce qui n’est pas un indice de robustesse. Ils auraient vécu il y a 30 000 ans environ.
En fin de compte, on ne peut raisonnablement attribuer à la lignée humaine que l’homo sapiens et sa dérivation en impasse que constitue l’homme de Neandertal. Ce ne sont que des hypothèses qu’il ne faut pas transformer en doctrine figée et incontestable par tous.
Conclusion
L’homme a raison de sonder son passé pour tenter d’y découvrir la clef du présent dans le secret de ses origines. Les évolutionnistes ont donc eu raison d’essayer. Mais ils ont tort de s’obstiner : aucune des preuves, prises séparément, n’est vraiment convaincante. On ne voit pas comment dix « preuves » boiteuses devraient êtres tenues pour une preuve valide. Avec dix piliers bancals, on ne fait pas un toit stable !
Mais comme nous l’avons vu en introduction, c’est souvent pour servir leurs idéologies matérialistes que les hommes les plus influents croient à l’évolutionnisme. C’est ce qu’on apprend à l’école. C’est le dogme officiel. L’homme ? Un singe qui a réussi. Rien de plus.
L’évolutionnisme est également au service d’une idéologie, d’un mythe du « progrès » qui décrit la lente montée de la vie et prend source dans la philosophie des Lumières selon laquelle l’accroissement du savoir et du pouvoir sur le choses va suffire à rendre l’homme meilleur : le mal est identifié à l’ignorance, et l’acquisition du savoir, des connaissances scientifiques et techniques, à un progrès humain. Le temps, échelle chronologique, devient aussi une échelle de valeur : tant qu’il y a changement, il y a amélioration. Dans cette optique, il semble bien que le transformisme raisonne comme si l’ensemble des êtres vivants ne constituait qu’un seul et même être vivant qui, en acquérant au cours du temps des opérations nouvelles, verrait sa nature se transformer, passant d’un type d’être considéré comme inférieur à un type supérieur, le stade ultime étant « l’hominisation ». Cet amalgame est absurde. L’évolutionnisme prouve le progrès, le progrès prouve l’évolutionnisme.
D’ailleurs, le mythe du progrès trouve une apparence de confirmation dans l’approfondissement des connaissances scientifiques et le perfectionnement des techniques… Mais ces progrès proviennent seulement du bénéfice que tirent les nouvelles générations de l’accumulation des progrès de leurs ancêtres : nos prix Nobel, s’ils avaient vécu à l’époque de Cro-Magnon, n’auraient fait rien d’autre que tailler des silex. On peut d’ailleurs observer que l’homme est toujours capable d’horreurs, comme les camps d’extermination.
Une conséquence de l’évolutionnisme est le fait que dès lors toute l’éthique se trouve bouleversée et les plus graves déviations morales justifiées. Par exemple, ce qui est accompli pour sélectionner et améliorer les races animales est tout autant justifié pour la race humaine… Il n’est pas jusqu’à l’homosexualité qu’un tel principe permet de justifier, son existence étant avérée chez certains singes : ce n’est donc que la « nature », même pas une « maladie ». Et ainsi de suite ! Il paraît qu’on veut même faire voter une déclaration des droits des singes…Le problème est qu’on assimile ainsi l’homme à un animal de plus, sur lequel on peut essayer autant d’expériences que sur d’autres animaux –tel l’expérimentation sur des embryons humains.
Sources :
-Daniel Raffard de Brienne, Evolution : mythe ou réalité (Lecture et Tradition n°143-144, janvier-février 1989)
– Daniel Raffard de Brienne, Il n’y a qu’un seul Dieu (Chiré 2003)
– L’évolution… ou l’homme créé à l’image du singe (Savoir et Servir n°62, 1er semestre 1998)
РAndr̩ Boulet, sm, La Gen̬se au risque de la science (2003)
РAndr̩ Boulet, sm, Cr̩ation et r̩demption (C.L.D. 1995)
– L’évolution : le retour du débat (La Nef, n°170, avril 2006, pp. 22-32)
– Jérôme Lejeune, Lettre à Virginie (document inédit)
Bibliographie
Contre
– Michael Denton, L’évolution : une théorie en crise, réed. Champs-Flammarion, 1993
– Michael Denton, L’évolution a-t-elle un sens, Fayard, 1997
РPhilipp E. Johnson, Le darwinisme en question. Science ou m̩taphysique ? Exergue, 1997
– Dominique Tassot, A l’image de Dieu. Préhistoire transformiste ou préhistoire biblique ?
– Daniel Raffard de Brienne, Pour en finir avec l’évolution, Perrin, 2004
РJ. Flori et H. Rasolofomasoandro, Evolution ou Cr̩ation ? ̩d. SDT, 1974
– Georges Salet, Hasard et certitude : le transformisme devant la biologie actuelle, Ed. Scientifiques St Edme, 1972
РEric Latour, G̩n̩tique et ̩volution
– Hugues de Nanteuil, Sur les traces d’Adam, Nouvel aperçu sur les origines de l’homme
– Jacques Arthaud, Evolution et transformisme
Pour
– Pascal Picq, Nouvelle histoire de l’homme, Perrin, 2005 (Intéressant pour avoir un point de vue évolutionniste honnête).
РJules Carles, Le transformisme, ̩d. Que sais-je ? 1970
РJacques Monod, Le hasard et la n̩cessit̩, Seuil, 1970